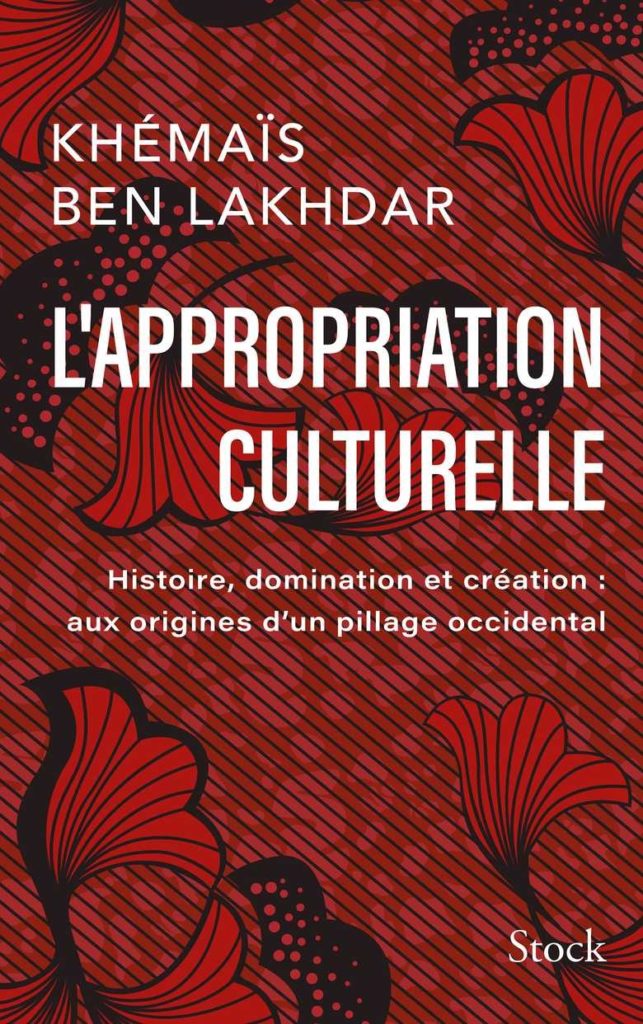M. L’arrivée des réseaux sociaux a permis de poser frontalement ces questions dites-vous, mais a également créé un point de rupture : comment sortir du débat binaire ?
KBL. Les réseaux sociaux ont ce pouvoir démocratique qui va permettre de faire porter à l’attention de tout le monde ce concept-là. Le problème, c’est que les réseaux sociaux et le militantisme en ligne ignorent parfois les mécanismes de probité scientifique, de la recherche, de la nuance, etc. Et surtout, les personnes qui sont sur ces réseaux sociaux ne sont pas nécessairement au courant de toute la définition et l’historiographie du concept. En France, les premiers gros “cas” d’appropriation culturelle sont arrivés en 2016 – 2017, je pense notamment aux coiffes d’Amérindiens sur les défilés Victoria’s Secret ou encore les fausses dreadlocks portées par des mannequins blanches lors d’un show Marc Jacobs. Donc la question commence à dater et pourtant, sur les réseaux sociaux, encore en 2024, on en est à “Qu’est-ce que c’est l’appropriation culturelle ?”, “Est-ce qu’en étant blanc, j’ai le droit de porter ça ? Est-ce qu’en étant racisé, j’ai le droit de porter ça ?”. Et en fait, ces questions empêchent de comprendre la dimension systémique de l’appropriation culturelle en tant que rapport de domination. Finalement, les réseaux sociaux, c’est génial puisque ça permet de poser frontalement cette question dans l’espace public et ça permet de porter la voix de personnes qu’on n’entendait jamais. Et en même temps, le bât blesse, parce que lorsqu’on utilise un concept qu’on ne maîtrise pas, ça ne fait jamais vraiment bon ménage.
M. Récemment, Louis Vuitton a été pris à partie par la Roumanie, furieuse de voir une blouse artisanale roumaine parmi la collection : pourquoi l’appropriation culturelle est encore si ancrée au sein de l’industrie de la mode ?
KBL. Parce que c’est systémique, et parce que la mode ne s’intéresse pas aux vraies questions et ne fait pas son examen de conscience en profondeur, seulement de la cosmétique. C’est ce que je trouve très intéressant avec ce cas de Vuitton qui est hyper parlant en termes d’appropriation culturelle. C’est-à-dire que pour la campagne de pub estivale, on va représenter une espèce de territoire, de plage tropicale paradisiaque. Et pour la collection, on va s’intéresser à un vêtement, à un savoir-faire de Transylvanie, donc de Roumanie : une broderie traditionnelle transylvanienne se retrouve translatée sur une plage tropicale, on ne sait pas où, tant qu’il y a du soleil, pour une clientèle majoritairement blanche et occidentale, qui veut simplement s’enjailler à la plage avec des choses comme ça. Donc, on est bien dans la décontextualisation et la re-sémantisation : on ne cite pas du tout ces sources parce qu’on s’en fiche, c’est juste beau, donc on appauvrit le sens.