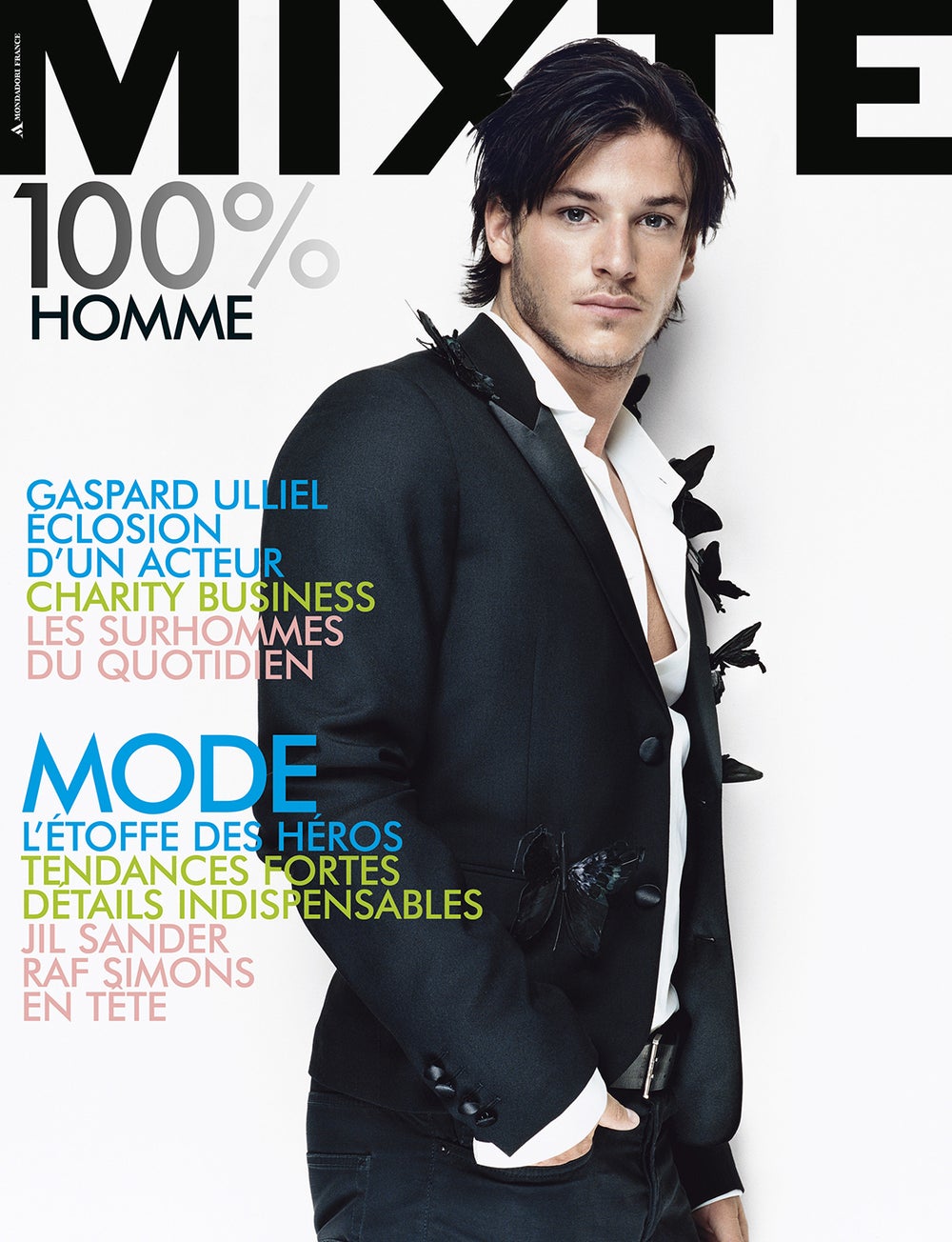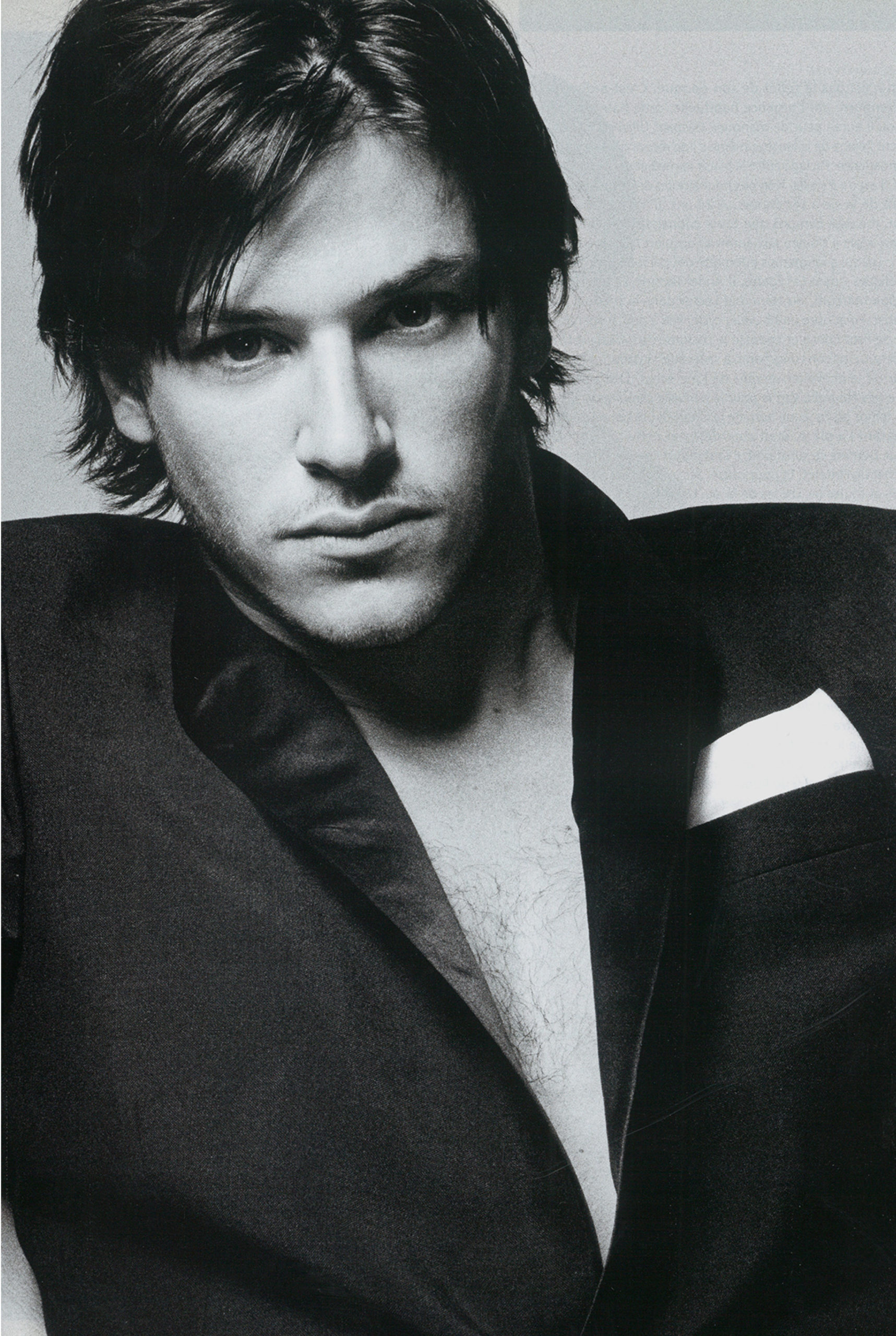M. Aimeriez-vous,comme Faust, accélérer la voie trop lente qui mène à la connaissance?
G.U. J’ai cette impatience. Sans que ce soit dramatique, adolescent, j’étais renfermé, timide. Même si j’avais des amis, je souffrais d’un sentiment d’infériorité. J’étais chétif. J’ai grandi d’un coup et très tard. Ce n’était pas un complexe, plutôt un mal-être. Un jour, je me suis dit que la vraie force, c’est la connaissance. Celle qui nourrit un homme de l’intérieur et lui donne de l’assurance. La connaissance a été un levier pour m’ouvrir et non un besoin d’accumulation. C’est quelque chose d’égoïste, une satisfaction personnelle. Une manière de regarder les autres autrement, de partager et d’acquérir cette confiance que je n’avais pas.
M. Impatient, cela veut dire que vous êtes ennemi de la lenteur?
G.U. Au contraire, j’aime prendre mon temps. C’est un vrai luxe. On me l’a d’ailleurs toujours reproché. Je fais partie de ceux qui font l’éloge de la lenteur. C’est comme ça qu’on devrait vivre. Être pressé, c’est pour moi une contrainte. Je suis mal à l’aise.
M. Pour faire référence à Saint-Exupéry, à quel moment avez-vous quitté la peau du Petit Prince pour celle de l’aviateur?
G.U. Je suis dedans, plus sur la fin d’ailleurs ! Mais je ne tourne pas complètement le dos au Petit Prince. J’ai soif de maturité, sans que ce soit obsessionnel. J’aspire à vieillir. Je trouve que plus la vie passe, plus elle s’intensifie. Plus jeune, je me sentais décalé. Aujourd’hui,je me sens plus en harmonie. Centré.
M. En entrant dans « l’âge d’homme », avez-vous l’impression de quitter la gravité de l’enfance?
G.U. Ça dépend dans quel sens on entend le terme « gravité ». J’aime ressentir le poids des années qui passent. Mon centre de gravité, c’est là que je le trouve. Je suis un terrien, j’ai besoin d’un appui physique, sinon j’ai un peu le vertige. Cette appréhension de l’espace est liée à une peur de lâcher prise. Pour moi, ceux qui sont à l’aise dans le vide sont des gens en accord avec eux-mêmes.
M. Au cinéma, vous avez souvent incarné un adolescent étrange, seul, isolé. On sent que ce parcours se modifie. Vous qui êtes entre deux âges, êtes-vous en train de devenir un autre?
G.U. Bien sûr, je change. Mais c’est l’affirmation de ce que j’avais en moi depuis toujours. Je crois au déterminisme : ce que nous sommes est soumis à un ensemble de causes extérieures. Le milieu dans lequel je suis comme le fait d’avoir commencé à travailler très tôt ont changé des choses en moi.Sans pour autant modifier profondément ma personnalité, je pense. Mon identité est en construction. Mon garde-fou,dans cette aventure, c’est ma rigueur – qu’on me reproche souvent. Je peux passer pour quelqu’un de dur. Si je sais être profondément ému, c’est quelque chose que je montre peu. Je ne suis pas démonstratif. Je retrouve cette fierté dans la culture japonaise. C’est très beau de voir quelqu’un s’abandonner à ses émotions, mais je ne peux pas. Je suis dans le contrôle. C’est là toute ma contradiction. Je suis dur,mais pas au point d’être insensible. C’est comme si je sentais les choses venir et que, tout à coup, un mur endiguait cette émotion. Je pense qu’il se cassera un jour.
M. Une école bilingue, un bac, un DEUG…Peut-on y voir le parcours d’un enfant discipliné ?
G.U. L’école me plaisait. Parfois,j’aimerais y retourner. Pour le mélange d’insouciance et de plaisir, celui des copains et des filles.En plus,on apprenait des choses. L’école, pour moi, e’est le domaine du jeu. Aujourd’hui,pour voir les gens, on est obligé de les appellera l’avance. Chacun a ses occupations. C’est contraignant. A l’école, on n’avait pas le choix. Chaque jour,on se retrouvait. Il y avait quelque chose de magique. Cette ambiance de partage et d’enthousiasme,je la retrouve sur les tournages.
M. De I’histoire grecque qu’on étudie à l’école à la culture de la BD, quels sont les héros qui ont accompagné votre enfance?
G.U. Avec la BD, je n’ai jamais accroché. Plus jeune, je considérais qu’elle appartenait au monde des adultes. Par ailleurs, je ne suis pas dans la culture « héros ». Probablement parce que j’ai du mal à me projeter en quelqu’un d’autre.
M. Du héros au super-héros, il n’y a qu’un pas que les Américains ont franchi au cinéma. Lequel d’entre eux auriez-vous aimé incarner?
G.U. Wonder Woman,pour sa poitrine (rires)…Ou L’homme invisible.Pas pour me cacher des autres mais pour le côté mesquin et pervers du voyeur.
M. Le super-héros, c’est celui qui éloigne une menace. Qu’est-ce qui vous fait peur dans la vie?
G.U. Ma voisine, le fisc… Moins prosaïquement, j’ai peur du vide. Quand j’évoquais tout à l’heure les lignes et les courbes que je traçais sur mes cahiers, c’était pour moi une façon d’appréhender l’espace, de donner une forme au vide. J’ai besoin de noircir la page blanche. C’est lié à ma peur de l’inconnu. Une forme d’appréhension et en même temps de fascination. L’idée de ne pas savoir, de ne pas maîtriser, de se lancer dans le vide.Je me rends compte que tout cela est contradictoire,mais j’assume. En fait, je crois que j’aime avoir peur. C’est jouissif !