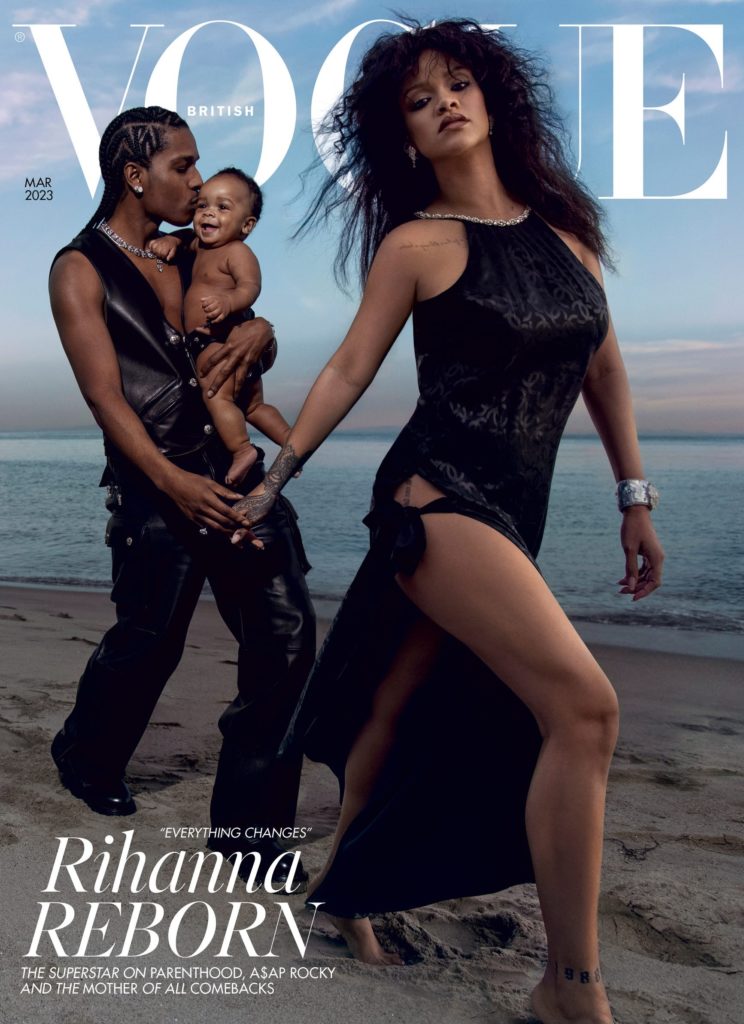Allô maman bobo
La mère se construit donc ainsi librement, en dehors des genres et des familles assignés à sa naissance. “Vous avez des mères, des mères homosexuelles, des pères homosexuels, des frères et sœurs homosexuel·le·s, des oncles homosexuels, etc. Il existe de véritables lignées que vous pouvez suivre et celles-ci remplacent les familles biologiques qui ont souvent renié leurs enfants”, expliquait dans ce même article du Time, Ricky Tucker, auteur du livre “And The Category Is…: Inside New York’s Vogue, House, And Ballroom Community”. La popularité de l’émission de télé-réalité RuPaul’s Drag Race et ses déclinaisons à travers le monde ont largement contribué à ce glissement sémantique dans la culture populaire de la Mother comme symbole d’empouvoirement et de bienveillance. D’autres événements sont venus nourrir dernièrement les nombreuses variations autour de la mère : à l’exposition de l’artiste brésilienne Tarsila do Amaral actuellement présentée au Musée du Luxembourg, le portrait “A Negra” représentant une “mère noire”, nous rappelle l’instrumentalisation des femmes esclavisées et afro-descendantes en tant que nourrices, jusqu’à la fin du XIXe siècle. Invisibilisées dans l’espace public, délaissées par les politiques publiques et cantonnées à rester dans les clous, ce constat violent, les journalistes Johanna Luyssen, Judith Duportail et Aline Laurent-Mayard l’ont fait encore récemment dans leurs essais respectifs Mères Solos et Maternités Rebelles et le podcast “Bienvenu-e Bébé”.
Leur discours, loin des mom-influenceuses parfaites, Trad Wives rétrogrades et dévouées et MILF objectifiées, s’émancipe des injonctions patriarcales et trouve amplement sa place dans les cercles militants queer et féministe, valorisant la notion de “care” (prendre soin) et les systèmes d’entre-aide. Dans son essai paru en 2020 “La puissance des mères”, la politologue et fondatrice du Front des mères (premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires), Fatima Ouassak montre “le potentiel politique stratégique des mères” et réaffirme que les mères “courage” peuvent soulever des montagnes. Gisèle Pélicot ne nous l’a que trop bien démontré ! Un changement de paradigmes qui séduit la GenZ portée par des qualités dites “maternelles” (bienveillante, empathique, rassurante, protectrice) qu’elle applique à ses ami·e·s et à sa famille choisie, faisant un pied-de-nez à la Girlboss, cet archétype carriériste et arriviste à souhait, érigée en modèle par leurs aîné·e·s les Millenials. Et de donner une nouvelle dimension au féminisme politique en y incluant toutes les mères. Pas sûr que cela aurait plu à Simone de Beauvoir. Pourtant, c’est bien connu, désormais on ne naît pas mère, on le devient.