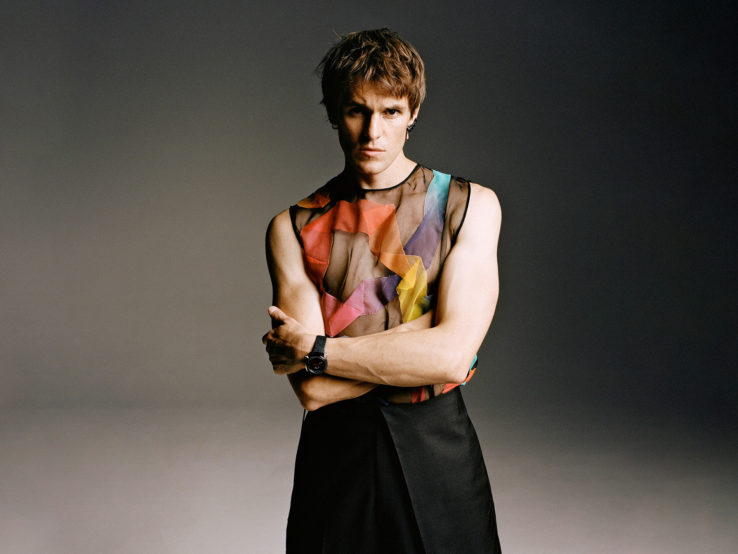M. Parce qu’elle consigne le sexe de façon très crue et froide, comme un sportif qui note ses résultats pour s’améliorer, et qu’on ne voit pas où est son plaisir ?
T. C. Sûrement… Esther ne prend pas de plaisir à proprement parler quand elle couche avec Jean, mais elle en a en le regardant, en sachant qu’elle fait l’amour avec lui, et que lui est bien. Mais en soi, l’acte la laisse indifférente. Elle ne recherche pas la jouissance. C’est acceptable, il n’y a pas de jugement, ni venant du film ni de moi. Mais c’est quand même la part tragique de son existence, et c’est probablement le cas pour beaucoup de femmes.
M. Dans la seconde partie de l’histoire, Esther trouve refuge chez des religieuses. Elle n’a sans doute pas la foi, mais le monastère est aussi un endroit dépourvu d’hommes – or, justement, la plupart des figures masculines du film sont médiocres voire nocives, que ce soit Jean, qui la rejette, ou son beau-père, qui lui manifeste un désir malsain. Est-ce que les espaces sans hommes sont des abris nécessaires ?
T. C. Il y a quand même des hommes bien dans le film : le serveur, le garçon qui la prend en stop. Et dans le monastère, c’est marrant, parce qu’à un moment, elle parle à la jeune retraitante, elle lui montre le jardinier au loin et elle dit : “Ah, je savais bien qu’il y avait un homme, ici !” Et puis, il y a Dieu aussi. Les nonnes ont un rapport très sensuel à Lui, quand on lit leurs textes : il est dans leur couche, elles sont ses femmes… Mais plus généralement, la non-mixité est une très bonne question, je m’interroge beaucoup sur sa nécessité. En l’état actuel des choses, je dirais qu’elle est réelle. Je ne l’ai jamais expérimentée, mais j’ai des amies qui ont fréquenté des lieux, des clubs, des soirées non mixtes, sans être forcément pour à la base, et elles disent qu’elles ne se sont jamais senties aussi safe.
M. J’ai lu que ce qui a d’abord frappé la réalisatrice Anna Cazenave Cambet chez toi, c’est la danse. Ça fait partie de toi ?
T. C. Effectivement. Je danse très souvent. J’adore ça. J’aime aussi regarder les gens danser, qu’ils soient bons ou moins bons danseurs. C’est un moment où on s’oublie.
M. Tu as des rôles modèles, des actrices préférées ?
T. C. J’adore Béatrice Dalle. Elle a une incroyable force. Quand elle brûle tout dans 37,2° le matin, j’adore. C’est la sorcière. En plus, elle a fait plein de films d’horreur, c’est trop bien.
M. De l’or pour les chiens a été pris à la Semaine de la Critique, mais Cannes n’a pas eu lieu, sa vie festivalière est donc particulière. Te sens-tu privée de quelque chose ?
T. C. J’étais hyper contente, c’est mon entourage qui était déçu pour moi. Avec Anna, on a pleuré de joie. J’étais allée me faire les ongles, et je reçois un appel d’elle : “On est prises à la Semaine de la Critique !” Je me suis mise à pleurer, j’ai hurlé. Et puis, tout le monde a essayé de me tuer le truc ! J’étais là : “Ta gueule, on s’en fout de Cannes !” Et maintenant, ça a déteint sur moi, je trouve ça un peu nul que Cannes n’ait pas lieu. C’est juste dommage pour le film, d’un point de vue business : il n’a pas la même couverture médiatique, le marché international, etc.
M. De manière générale, entrer dans le monde du cinéma sur une année aussi noire, pour les exploitants, pour les festivals, est-ce dur ? Comme arriver alors que la fête est finie ?
T. C. Oui et non. C’est dur, mais c’est la seule année que je connais, et pour moi, c’est une année formidable. Bien sûr, que c’est triste… mais il y a des choses plus graves, non ?
M. Tu viens de signer chez une grosse agence, UBBA. Quels films as-tu envie de faire ?
T. C. Je me rends compte que ce n’est pas si souvent que les acteurs sont fiers du film qu’ils ont fait, au-delà de leur propre performance ou de leur rôle. Moi j’éprouve une immense fierté pour De l’or pour les chiens. C’est ce sentiment que j’ai envie de garder, être fière de mes films, qui correspondent à ce que j’aime voir. C’est bizarre de dire ça après un seul tournage, mais les premiers films aussi, je trouve ça bien. Rester dans l’inconnu, faire confiance aux gens, et notamment aux jeunes.